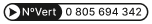Créer une EURL associé unique : étapes clés
L'article en un clin d'œil
- Structure et protection : L'EURL est une SARL à associé unique offrant une responsabilité limitée et protégeant le patrimoine personnel, créée en 4 étapes (statuts, dépôt capital, annonce légale, immatriculation) pour un coût de 179-202€
- Flexibilité fiscale et sociale : Choix entre régime IR (par défaut) ou IS (option à 25%), statut TNS avec cotisations sur bénéfices/rémunération, optimisation possible via arbitrage salaire/dividendes selon le seuil de 10% du capital
- Capital et gestion simplifiée : Capital libre dès 1€ (montant réaliste recommandé), apports en numéraire ou nature, décisions unilatérales sans blocage, idéal pour entrepreneurs souhaitant structure solide sans complexité SARL classique
Qu'est-ce qu'une EURL ? définition et caractéristiques
Une SARL avec un seul associé
L'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) est une SARL composée d’un seul associé. Ce statut juridique permet de bénéficier d’une responsabilité limitée, tout en simplifiant les démarches par rapport à une SARL classique.
L'associé unique concentre tous les pouvoirs décisionnels. Il peut être une personne physique (même non majeure sous conditions) ou morale (autre société). Les règles de fonctionnement sont identiques à une SARL, mais adaptées à l’absence de pluralité des associés. Les décisions s’imposent sans débat, évitant les blocages fréquents en SAR.
La protection du patrimoine de l'associé unique
Le principal avantage de l'EURL est la protection du patrimoine personnel de l’associé. Sa responsabilité est limitée au montant de ses apports au capital social. En cas de difficultés financières, ses biens personnels (logement, épargne) ne sont pas engagés. Sans EURL, un entrepreneur individuel risquerait tout son patrimoine.
Cette protection peut être levée en cas de faute de gestion, de caution personnelle pour un prêt ou de surévaluation des apports en nature. C’est un point crucial par rapport à l’entreprise individuelle, où le patrimoine est indistinct.
Pour quelles activités ?
L'EURL convient à des activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. Elle offre une flexibilité sectorielle adaptée à la plupart des projets entrepreneuriaux.
Certaines professions réglementées (ex. débit de tabac) ou activités civiles (gestion immobilière, location nue) sont toutefois exclues. Ces exceptions existent pour préserver le cadre légal spécifique de l’EURL. Les métiers libéraux (avocats, médecins) restent autorisés sous réserve de respecter les codes de déontologie propres à leur profession.
Les 4 étapes clés pour la création de votre EURL
La rédaction des statuts : le document fondateur
Les statuts définissent les règles de votre EURL. Si vous êtes l’associé unique et gérant, utilisez un modèle simplifié prévu par un décret. Ils doivent inclure des mentions obligatoires : dénomination sociale (nom unique), objet social (activités autorisées), siège social (adresse administrative), capital social (1 euro minimum), durée de la société (jusqu’à 99 ans), et modalités de fonctionnement (décisions unilatérales).
- Dénomination sociale : choisissez un nom non utilisé.
- Objet social : précisez vos activités.
- Siège social : indiquez une adresse valide.
- Capital social : fixez un montant minimal.
- Durée de la société : jusqu’à 99 ans.
- Modalités de fonctionnement : gestion et décisions unilatérales.
Une erreur dans ces mentions bloque l’immatriculation. Un oubli sur la durée ou le capital entraîne un retour de dossier. Les décisions unilatérales doivent être consignées dans un registre spécial.
Le dépôt du capital social
Votre capital doit être déposé sur un compte bloqué au nom de la société en formation. Les fonds restent inaccessibles jusqu’à obtention de l’extrait Kbis. Les apports en numéraire nécessitent un minimum de 20% à la constitution, le solde en 5 ans maximum. Les apports en nature (biens) doivent être évalués par un commissaire aux apports si leur valeur dépasse 30 000 € ou 50% du capital social.
Un certificat de dépôt est indispensable. Une négligence expose vos finances personnelles. 90% des refus proviennent de dossiers incomplets, comme un certificat manquant ou des fonds non bloqués. Les fonds déposés deviennent la trésorerie de l’entreprise après immatriculation.
La publication de l’avis de constitution
L’annonce légale se publie dans un journal habilité (JAL) ou via un service en ligne. Elle informe tiers de votre activité. Le coût varie selon la région : 123 € HT en métropole, 146 € HT à La Réunion. Conservez l’attestation de parution : elle est obligatoire pour l’immatriculation.
Omettre cette étape est une erreur fréquente. 30% des débutants y oublient ce détail, rendant la société illicite. Sans publication, la société n’est pas considérée comme formée légalement.
L’immatriculation au guichet unique
Depuis 2023, l’immatriculation se fait en ligne via e-procédures.inpi.fr. Le dossier doit inclure :
- Statuts signés.
- Attestation de dépôt du capital.
- Attestation de parution de l’annonce légale.
- Déclaration des bénéficiaires effectifs.
- Pièce d’identité du gérant.
- Déclaration de non-condamnation.
Un dossier complet évite les retards. En 2023, 15% des demandes ont été rejetées pour des erreurs évitables. Par exemple, un justificatif d’identité expiré ou une déclaration de non-condamnation non signée entraîne un refus immédiat. Utilisez le tableau de bord du Guichet Unique pour suivre votre demande en temps réel. Si vous utilisez un mandataire, joignez un modèle de mandat à votre demande.
Le capital social : que faut-il savoir ?
Le capital social d'une EURL peut être fixé à 1 € symbolique. Aucune loi n'impose de montant minimum, mais un choix réaliste reste crucial. Un capital trop bas nuit à la crédibilité auprès des banques et partenaires. C’est le premier signe de solidité de votre entreprise. Il influence aussi votre capacité à obtenir des prêts ou des contrats.
Un montant libre, mais réfléchi
Le capital social n’a pas de plafond légal. Opter pour 1 € présente des risques : un montant insuffisant ne couvre pas les frais initiaux (locaux, matériels, salaires) et peut freiner les financements. Les tiers (banques, fournisseurs) jugent souvent la solidité d’une entreprise à la hauteur de son capital. Un montant cohérent avec votre business plan garantit crédibilité et stabilité à long terme. Par exemple, un projet digital peut se contenter de 10 000 €, tandis qu’un commerce physique nécessite souvent plus pour couvrir les coûts fixes.
Les apports en numéraire et en nature
Deux types d’apports existent. Les apports en numéraire (liquidités) exigent un versement initial de 20 % à la création, le reste étant réglé en 5 ans. Les apports en nature (matériel, immeuble, etc.) nécessitent une évaluation. Si la valeur dépasse 30 000 € ou représente plus de 50 % du capital, un commissaire aux apports est obligatoire. Une mauvaise évaluation engage votre responsabilité personnelle pendant 5 ans, avec des risques de redressement fiscal ou pénal.
Le dépôt des fonds se fait dans un compte bancaire bloqué avant l’immatriculation. La banque fournit une attestation indispensable pour l’enregistrement au RCS. Si la société n’est pas créée en 6 mois, vous pouvez récupérer vos fonds via une procédure légale. Retenez : le capital choisi influence votre accès au crédit et vos relations commerciales. Un montant adapté à votre activité évite les blocages financiers. Les formalités de dépôt, bien que simples, nécessitent précision pour éviter des retards dans la création.
Le régime social et fiscal : les choix crucaux pour l'associé unique
Le statut social du gérant : travailleur non-salarié (TNS)
Si vous êtes à la fois l'associé unique et le gérant de votre EURL (ce qui est le cas le plus courant), vous devenez Travailleur Non-Salarié (TNS). Ce statut vous rattache au régime général de la Sécurité sociale via la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
Vos cotisations sociales se calculent sur la base de vos bénéfices ou de votre rémunération. Attention, contrairement aux salariés, vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. Vous n'y aurez donc pas droit en cas de cessation d'activité.
En cas de non-rémunération, vous devrez quand même payer des cotisations minimales pour valider des droits sociaux, notamment pour la retraite. Votre protection sociale reste globalement plus limitée que celle d'un salarié classique.
La fiscalité de l'EURL : impôt sur le revenu (IR) ou sur les sociétés (IS) ?
Votre EURL démarre automatiquement sous le régime de l'Impôt sur le Revenu (IR). Vous pouvez toutefois opter pour l'Impôt sur les Sociétés (IS) selon votre stratégie fiscale.
| Impôt sur le Revenu (IR) | Impôt sur les Sociétés (IS) |
| L'associé unique | La société |
| Totalité du bénéfice | Bénéfice de la société |
| Sur le bénéfice total | Sur la rémunération et les dividendes perçus |
| Calculées sur le bénéfice total | Calculées sur la rémunération + une partie des dividendes |
| Début d'activité ou déficit prévu | Bénéfices réinvestis, optimisation de la rémunération |
Sous le régime de l'IR, vous déclarez les bénéfices de votre EURL dans votre déclaration de revenus personnelle (rubrique BIC ou BNC). Vous ne pouvez pas vous verser de dividendes et vos cotisations sociales se calculent sur l'intégralité du bénéfice.
L'option IS s'adresse aux EURL générant des bénéfices réguliers que vous souhaitez réinvestir. Vous payez l'IS à 25% (ou 15% sous certaines conditions). L'associé unique se déclare alors des revenus en tant que salarié ou via des dividendes.
Attention, cette option devient irrévocable après 5 exercices comptables. Elle nécessite aussi une gestion plus complexe avec déclaration trimestrielle d'acomptes.
Le cas particulier de l'option micro-entreprise
Si votre EURL est à l'IR et que vous en êtes le gérant, vous pouvez opter pour le régime de la micro-entreprise. Ce choix simplifie vos obligations comptables et fiscales, mais il n'est pas toujours optimal selon votre situation.
Vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires (50% pour les services, 71% pour le commerce) sans avoir à justifier de frais réels. Cependl, vous ne pouvez déduire aucun frais supplémentaire. Ce régime reste avantageux uniquement si vos charges réelles sont inférieures aux abattements forfaitaires.
Attention aux plafonds de chiffre d'affaires : 188 700 € HT pour les activités commerciales et 77 700 € HT pour les activités de service. Dépasser ces seuils vous fait sortir du régime micro, sans possibilité d'y revenir.
Optimiser votre rémunération : salaire ou dividendes ?
Rémunération du gérant versus dividendes : quel impact ?
En EURL, deux options s'offrent au gérant associé unique pour se rémunérer : une rémunération de gérance ou des dividendes. La rémunération est assimilable à un salaire, déductible du résultat de la société, tandis que les dividendes correspondent à une distribution annuelle des bénéfices, non déductible. Le choix entre ces deux modes influence directement la fiscalité et les charges sociales. Par exemple, en EURL soumise à l'IS, une rémunération réduit le bénéfice imposable, mais génère des cotisations sociales élevées (environ 45 %). Les dividendes, quant à eux, n'ouvrent pas droit à la protection sociale mais offrent des avantages fiscaux sous certaines conditions.
L'influence sur les cotisations sociales TNS
Les règles de prélèvement de cotisations sociales diffèrent selon le mode de rémunération. La rémunération de gérance est soumise aux cotisations sociales TNS, calculées sur le revenu net (environ 45 %). Les dividendes suivent une logique plus complexe : seuls ceux dépassant 10 % du capital social sont assujettis aux mêmes charges sociales. Cela signifie qu’un versement exclusif de dividendes ne permet pas d’éviter les cotisations si la somme distribuée dépasse ce seuil. Par exemple, un capital de 100 000 € autorise 10 000 € de dividendes annuels sans charges supplémentaires. Au-delà, les cotisations s’appliquent sur la fraction excédentaire.
Maintenir ses aides Pôle Emploi (ARE/ARCE) avec une EURL
Le choix entre salaire et dividendes a des répercussions sur les aides chômage. Pour l’ARE, l’absence de rémunération garantit le maintien intégral des allocations. En revanche, un salaire réduit l’aide de 70 % du montant déclaré, tandis que les dividendes soumis aux TNS sont partiellement pris en compte. Pour l’ARCE, opter pour un capital plutôt qu’un paiement mensuel permet de conserver 60 % des droits ARE sous forme de capital, libérant de la contrainte de déclaration mensuelle. Attention : les dividendes ne dépassant pas 10 % du capital social n’affectent pas le calcul de l’ARE, facilitant le maintien des aides si aucun salaire n’est versé. Une stratégie commune consiste à ne pas se verser de rémunération pour préserver l’intégralité de l’aide, tout en validant des droits à la retraite via les cotisations sociales sur les dividendes soumis au seuil des 10 %.
Combien coûte la création d'une EURL ?
Créer une EURL implique des dépenses incontournables et des frais optionnels. Voici une vue claire des coûts à anticiper pour éviter les mauvaises surprises.
Les frais administratifs obligatoires
Les dépenses légalement requises pour immatriculer votre EURL incluent plusieurs postes de dépense :
- Publication dans un journal d'annonces légales (JAL) : Entre 123 € et 146 € HT selon le département. Ce prix est fixe et réglementé.
- Frais de greffe pour l'immatriculation au RCS : Environ 35,59 € pour l'inscription au Registre National des Entreprises (RNE).
- Déclaration des bénéficiaires effectifs (RBE) : 20,34 € pour l'enregistrement initial, mais des frais supplémentaires s'appliquent en cas de dépôt tardif (jusqu'à 54,42 € TTC).
Ces coûts varient légèrement selon les régions, mais ils représentent des dépenses incompressibles pour la légalisation de votre société.
Les coûts annexes à prévoir
Outre les frais obligatoires, d'autres dépenses dépendent de vos choix :
Un accompagnement par un expert-comptable ou une plateforme juridique en ligne peut coûter entre 100 € (services en ligne) et 2 000 € (cabinet spécialisé) pour la rédaction des statuts. Le dépôt du capital social génère des frais bancaires variables : 0 € si vous choisissez une banque traditionnelle, 69-100 € HT pour une néobanque (ex. Qonto à 69 € HT). Enfin, des services comme l'ouverture d'un compte professionnel ou des conseils juridiques peuvent alourdir le budget, mais restent facultatifs.
La création d'une EURL reste accessible : en totalisant les dépenses obligatoires et en réalisant certaines démarches soi-même, le coût total oscille entre 185 € et 1 700 €. Opter pour des solutions digitales réduit les frais, tandis que l'aide d'un professionnel garantit une procédure sans erreur, mais à prix plus élevé.
L'EURL, SARL à associé unique, protège le patrimoine personnel via une responsabilité limitée. Création simplifiée (statuts, capital, formalités), choix fiscal (IR/IS) et rémunération optimisable. Équilibre entre flexibilité juridique et contraintes administratives. Idéale pour projets exigeant structure solide sans complexité d'une SARL classique.